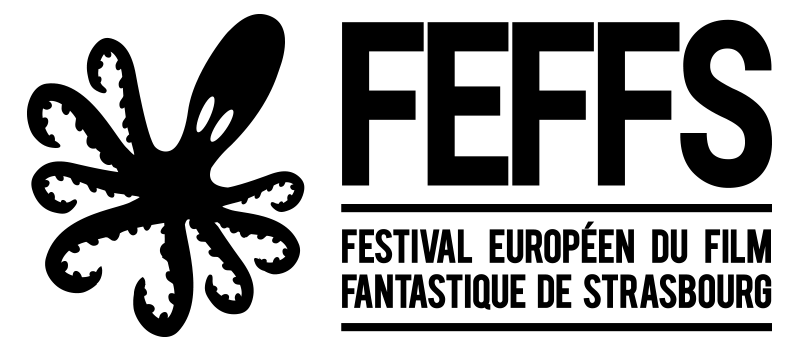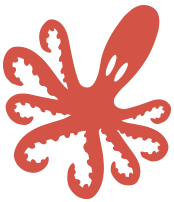A force d’entendre quotidiennement aux informations le nombre de morts, cela devient presque normal, puis l’annonce du décès d’une personnalité ou d’un proche vient nous secouer dans notre confinement et nous rappeler la triste réalité que nous vivons.
Ce dimanche, c’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de l’acteur Philippe Nahon, qui était membre du jury de la première édition de notre festival en 2008. Homme de théâtre et de cinéma, il était une des gueules du cinéma français. Une gueule mais aussi une voix, un regard et un caractère. Son premier rôle de cinéma, ce sera dans Le Doulos de Jean-Pierre Melville qui le fera mourir dans les bras de Serge Reggiani et inaugurera une longue carrière allant du film de genre comme Haute tension d’Alexandre Aja ou Calvaire de Fabrice du Welz au road movie de Bouli Lanners Eldorado, en passant par Mammuth de Kervern et Delépine ou même un petit rôle dans Le Cheval de guerre de Steven Spielberg.
Mais si l’on doit citer un réalisateur qui a compté dans la carrière de Philppe Nahon, c’est sans doute Gaspar Noé qui lui a confié un rôle à sa mesure dans Carne, puis Seul contre tous et Irréversible. Dans Libération, Gaspar Noé dit au revoir à son acteur mais surtout à son ami. Nous voulions partager ce texte puissant, témoignage sur le cinéma, la vie et l’amitié.
« Philippe, mon grand ami, je viens d’apprendre que tu t’es éteint, que tu ne seras plus, que ta mémoire et ta vie se sont fondues dans le grand vide, là où il n’y a plus de sens, ni de temps ni d’espace. Je n’aurai plus la douce chance de te serrer dans mes bras, comme il y a un mois, à la veille du confinement général. Depuis cet après-midi où nous avons pu rire une dernière fois ensemble le temps s’est arrêté. Un ennemi invisible a fait de notre ville un étrange paradis fantomatique, mélancolique. On dort. On mange. On dort encore. On suit les infos. On compte les malades. On compte les morts. Et aujourd’hui ton nom s’ajoute à cette longue liste qui ne cesse de croître. On est comme dans un rêve, répétitif, auquel on croit sans vraiment y croire. Désormais, le temps qui t’a construit et qui m’a permis de te rencontrer continuera pour d’autres, qui s’éteindront à leur tour.
Nous, on s’est connus il y trente ans, je rêvais de m’amuser à faire du cinéma, comme Buñuel ou comme Franju. Toi, de vingt-cinq ans mon aîné, tu en faisais déjà depuis longtemps. Au retour de cette sale guerre coloniale que tu n’avais pas réussi à déserter et qui t’a valu trois ans de camp disciplinaire, tu avais commencé à faire du cinéma avec Reggiani et Melville. Moi, je voulais faire un premier film avec un personnage masculin qui soit la quintessence de ce que je croyais être un homme normal, donc complexe et le plus souvent perdu. Ce « héros » devait être bien plus âgé que moi. C’était un vrai homme qu’il fallait, d’une cinquantaine d’années, avec un visage universel et intemporel comme celui de Jean Gabin. Je voulais un Gaulois, direct et sentimental. J’ai vu une photo de toi et le coup de foudre a été immédiat. Tu es venu chez moi, un peu imbibé, et rigolard face à ce jeune étranger à la diction inaudible. Tu rêvais de vrais rôles. Jouer, te transformer, pour t’amuser, pour te faire de nouveaux amis.
Enfant avec ta famille tu avais survécu à la Seconde Guerre et plus tard, cette fois seul, à celle d’Algérie à laquelle tu avais été contraint de participer. Tu avais survécu aux plaisirs de l’alcool et du tabac. Et même à la frustration de ne pouvoir incarner d’autres hommes aussi charismatiques que toi. On s’est adoptés immédiatement et je t’ai présenté celle qui jouerait ta fille. En un rien de temps l’affaire était bouclée. On partait victorieux ! On a fait Carne. Tu étais devenu mon boucher confus et humain, trop humain. Tu as apporté tellement de grâce à ce personnage qui, par ses actes et ses pensées, était ton antithèse, qu’après ce premier forfait, plutôt que de tourner un long métrage avec de vrais moyens, je ne voulais qu’une chose : continuer la même histoire avec toi, une suite qu’elle soit courte ou longue, mais avec toi, et en poussant toujours plus loin cet homme acculé et enragé qu’on ne pouvait s’empêcher d’aimer. Le titre est venu très vite : Seul contre tous. Ça devait être un autre moyen métrage, mais après deux ans de petits tournages épars et fauchés, cette suite est devenue un film à part entière. Encore plus qu’avant nous étions devenus de grands alliés, de vrais amis qui pouvaient tout se demander, sauf l’argent qu’on n’avait pas. Le film serait de nouveau porté par les pensées chaotiques du boucher, avec cette spectaculaire voix grave, chaude et anachronique qu’était la tienne. Et l’unique fois où tu m’as dit non, c’est lorsqu’on a enregistré cette voix off qui devait dire : « L’amour, l’amitié, ça n’existe pas. Tout ça, c’est du pipeau. »
Toi, tu croyais très profondément à l’amitié et ça te paraissait inconcevable de prononcer ces mots-là. Je t’ai donné raison, même si je protestais que le boucher était un homme en dépression et que de toute façon, il n’était pas toi. Tu l’as enregistré quand même. Nos regards se sont croisés et j’ai compris à cet instant que ce personnage était en fait un mélange de nous deux. Qu’on se battait ensemble, parmi tous et contre tous, pour jouir au maximum de ce terrain de transgression que peut être le cinéma. On a fini fièrement ce film, puis tu en as fait beaucoup d’autres, essentiellement avec de jeunes réalisateurs qui s’identifiaient eux aussi à toi. Et lorsque j’ai pu faire ma première production commerciale, Irréversible, j’ai tenu à ce que le film s’ouvre avec toi, et avec des plans plus proches que pour tous les autres personnages de l’histoire. On est restés soudés toutes ces années, tels deux frères ou un neveu et son oncle préféré. Browning avait rencontré son Lon Chaney, Scorsese son De Niro. Et moi, loin de ces géants, je t’avais quand même rencontré toi, et je n’aurais jamais pu souhaiter mieux.
Il y a quelque mois je m’étais acheté une nouvelle caméra pour tourner de manière semi-documentaire un épilogue à la vie de notre boucher. Après ton accident, tu avais du mal à mémoriser les mots. Aussi je me faisais un plaisir à imaginer un film sans dialogues préécrits.
Mais le monde nous réservait une surprise de taille. Ces tout derniers jours, tu as peut-être entrevu un futur qui ne marche pas vraiment. Nos rues sont vides, et sous le soleil, les gens ont peur du présent comme de la suite. Ce virus non-vivant qui se nourrit de la vie des autres s’est frayé un chemin jusqu’à ton corps déjà très affaibli par d’autres maux, et t’a emporté. J’espère que tes derniers instants ont été doux. Les antidouleurs apportent parfois une paix qu’on ne rencontre pas autrement. Dans la situation actuelle, il n’y a pas eu d’accolades finales, tu as dû partir seul. Il n’y a pas d’enterrement, pas de cérémonie. Je ne pourrai pas pleurer avec tes proches. Pour l’instant, chacun fera son deuil, seul et comme il pourra. Seul, et sans toi.
La vie passe. Mais pas l’amour de ta femme Elisabeth ni de votre fille Nelly ou de vos petits-fils Gabin et Nino, pas plus que mon amitié sans filtre ni l’empathie des spectateurs, cinéastes et amis qui ont eu la chance de te découvrir sur un écran ou dans la vie. Les hommes s’en vont, mais avec un peu de chance certaines de leurs traces restent. Ta voix ne nous réchauffera plus mais ses échos résonneront toujours en moi.
Ah, Philippe, qu’est-ce qu’on s’est amusé ! L’amitié, ça existe. C’est toi qui avais raison. »
Gaspar Noé, cinéaste